La portée musicale, constituée d’un ensemble de cinq lignes parallèles et horizontales, est l’un des fondements du solfège, un système de notation permettant d’écrire et de lire la musique occidentale.
Apprenez à lire les notes en 1 SEMAINE : JOUEZ MAINTENANT !
AFFICHER/MASQUER LE SOMMAIRE
Lignes et interlignes de la portée musicale
L’espace compris entre chaque ligne se nomme interligne. Les notes de musique se placent sur les lignes ou dans les interlignes.
Les lignes, comme les interlignes, se comptent toujours de bas en haut :
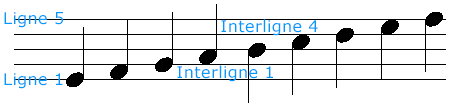
En plus des notes, la portée musicale accueille également les autres symboles musicaux comme les clefs (sol, fa, ut), les silences (pause, demi-pause, soupir…) et les altérations (dièse, bémol, bécarre…).
Les lignes supplémentaires
Pour écrire les notes qui dépassent la capacité des cinq lignes traditionnelles, le solfège ajoute des lignes supplémentaires dont la longueur est adaptée à la largeur de la note qu’elles supportent.
Ces courtes lignes sont ajoutées au-dessus de la portée pour les notes aiguës, en dessous pour les notes graves. Elles permettent ainsi d’étendre la tessiture de la portée en fonction de l’instrument ou la voix du chanteur afin de noter précisément chaque hauteur de son.
Ci-dessous, les trois premières notes au début en en-dessous de la portée du haut – La, Si, Do – et les trois dernières notes à la fin et au-dessus de la portée du bas – La, Si, Do également – utilisent des lignes supplémentaires.
Débutez ou améliorez votre lecture musicale avec l'aide des notes en couleur !
Autre type de portée
Traditionnellement, la notation des neumes en chant grégorien se fait toujours sur des portées à quatre lignes.
Les éléments des instruments à hauteur unique (comme les tambours, les cymbales, les castagnettes, les triangles, etc.) dont seul le rythme est considéré, sont habituellement notés sur une seule ligne.
Les clés (sol, fa, ut)
Pour fixer le nom de chaque note de musique sur une portée, on place l’une des trois clés (ou clefs) musicales au début de celle-ci :
- La clé de Sol se place sur la seconde ligne.
- La clé de Fa sur la troisième ou la quatrième ligne.
- La clé d’Ut (Do) sur la première, seconde, troisième ou quatrième ligne.
Une fois le nom de l’une des notes fixée avec l’une des trois clefs, le nom des autres notes suit l’ordre de la gamme musicale. Par exemple, avec la clé de Sol :
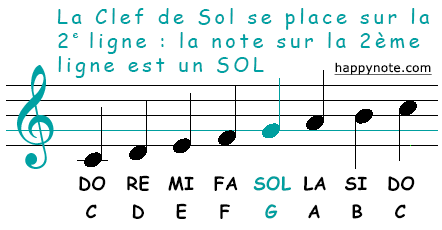
Les silences musicaux
En musique ou en solfège, le silence – pause, demi-pause, soupir… – est un symbole musical placée sur la portée. Il indique l’interruption momentanée du son dans l’exécution de l’oeuvre musicale.
Les altérations musicales
Les altérations musicales (dièse, bémol, bécarre, double dièse, double bémol), symboles musicaux permettant de modifier d’un ou deux demi-tons chromatiques la hauteur d’une note de musique, se placent également sur la portée. Soit au début du morceau, juste après la clé musicale (altérations constitutives appelées armure de la clé), soit devant une note (altération accidentelle).
Une brève histoire de la portée musicale
Si la portée à cinq lignes nous semble aujourd’hui une évidence, son invention fut une véritable révolution qui a mis plusieurs siècles à se dessiner. Comprendre son origine permet de mieux saisir son importance fondamentale dans la musique occidentale.
La notation par neumes
Au début du Moyen Âge, la musique, principalement le chant grégorien, était notée à l’aide de neumes. Ces signes, placés au-dessus du texte liturgique, indiquaient le contour mélodique (si la mélodie montait ou descendait) mais pas la hauteur exacte des notes ni leur intervalle. Cette notation, dite in campo aperto (en champ ouvert), reposait entièrement sur la mémoire du chantre qui devait déjà connaître la mélodie
L’invention de Guido d’Arezzo au XIe siècle
L’avancée décisive survient au début du XIe siècle avec le moine bénédictin italien Guido d’Arezzo (vers 992-1050). Pour remédier à l’imprécision des neumes, il systématise l’usage de lignes horizontales où chaque position représente une hauteur de son fixe et identifiable. Cette innovation fondamentale le consacre comme l’inventeur de la portée musicale moderne.
Combien de lignes au départ ?
Guido d’Arezzo a établi une portée de quatre lignes, le tétragramme. Devenue la norme pour le chant grégorien, elle est encore utilisée de nos jours.
C’est l’ajout d’une clé (Do ou Fa) pour fixer une hauteur de référence qui a rendu la lecture à vue possible. Cette invention aurait réduit le temps de formation d’un chantre de dix ans à moins d’un an.
L’évolution vers la portée à cinq lignes
Avec le développement de la polyphonie et de la musique instrumentale aux siècles suivants, la tessiture des œuvres s’est élargie. La portée musicale à quatre lignes devenait insuffisante pour noter des mélodies plus complexes et étendues.
La cinquième ligne a commencé à apparaître progressivement à partir du XIIIe siècle. Son usage s’est généralisé en France au XVIe siècle pour devenir le standard que nous connaissons aujourd’hui : le pentagramme (du grec pente, cinq, et gramma, lettre/écriture). Cette portée à cinq lignes offrait le compromis idéal pour noter la plupart des mélodies vocales et instrumentales de l’époque.
Le défi de la tessiture : les portées géantes de plus de 10 lignes
A certaines époques, notamment durant la Renaissance et le début de la période baroque, des portées contenant bien plus que cinq lignes ont été utilisées.
Cette pratique était particulièrement courante dans la notation pour les instruments à clavier, comme l’orgue ou le clavicorde, dont la tessiture était bien plus large que celle d’une voix humaine. Pour éviter l’usage excessif de lignes supplémentaires, certains compositeurs et copistes ont simplement utilisé une seule grande portée de 8, 10, 11, voire parfois jusqu’à 15 lignes pour noter la musique.
La Grande Portée
Identifier si une note se trouve sur la 7ème ou la 8ème ligne est extrêmement difficile pour l’œil humain : cela demande un effort cognitif important qui ralentit considérablement le déchiffrage.
C’est pourquoi on a adopté le système que nous connaissons aujourd’hui pour le piano. Il consiste à utiliser deux portées à cinq lignes superposées et reliées par une accolade :

Ce système s’est avéré infiniment plus lisible et est devenu la norme pour les touches noires et blanches du clavier du piano – mais aussi de l’orgue, du clavecin, du célesta… –, de la harpe et d’autres instruments à large tessiture. Il a prouvé que la clarté d’une grille de 5 lignes était un atout cognitif trop précieux pour être abandonné.
Combien de portées musicales sur une partition ?
Le nombre de portées sur une partition varie selon l’effectif musical. Il va de une seule portée pour un instrumentiste soliste à des configurations beaucoup plus complexes.
La partition courante d’un piano acoustique ou digital de 88 touches en utilise deux, mais des œuvres virtuoses de compositeurs comme Albéniz ou Rachmaninoff peuvent en exiger trois, voire quatre.
L’orgue requiert systématiquement trois portées pour intégrer le jeu du pédalier.
Le sommet est atteint avec la partition d’orchestre, qui superpose plusieurs dizaines de portées, une pour chaque pupitre d’instruments.