Le rythme, la mesure et le tempo — fixé par le métronome — sont trois composantes de la musique qui définissent son mouvement et son caractère. Ils utilisent les différentes figures de notes ainsi que les silences musicaux pour exprimer le temps musical.
Bien que distincts, le rythme, la mesure et le tempo sont indissociables. Une structure rythmique n’acquiert son sens et son caractère qu’une fois structurée par la mesure et jouée à un tempo donné.
AFFICHER/MASQUER LE SOMMAIRE
Le rythme
Le rythme désigne l’organisation des figures de notes et des silences dans le temps. C’est la structure qui naît de la succession de leurs différentes durées, indépendamment de la hauteur des sons.
Présent dans toutes les cultures, il constitue l’un des éléments fondamentaux de la musique, au même titre que la mélodie et l’harmonie. Le rythme est intimement lié au mouvement et à la danse : il accompagne le geste, guide la marche et structure le discours musical comme le langage parlé.
Pour représenter graphiquement des durées différentes, les figures de notes sur la portée musicale ont des formes et des noms différents : consultez notre page dédiée à la valeur des notes en musique (ronde, blanche, noire, croche…).
De la même manière, l’absence momentané de son doit être précisément indiquée. Pour cela, les compositeurs utilisent des symboles musicaux appelés « silence » qui peuvent devenir des composants actives du rythme au même titre que les notes : consultez notre page sur les silences musicaux (pause, demi-pause, soupir…).
Ils créent aussi des respirations et contribuent à instaurer la tension ou le repos.
Les motifs rythmiques
L’agencement des différentes valeurs de notes et de silences crée des motifs, aussi appelés cellules rythmiques. Un motif est une courte séquence reconnaissable qui peut être répétée, variée ou développée au sein d’un morceau.
L’alternance entre des notes courtes et longues, comme deux croches suivies d’une noire, est un exemple de motif rythmique courant. Dans le jazz, l’usage du contretemps ou du swing illustre l’importance de ces cellules.
Dans la musique classique, des compositeurs comme Beethoven ou Stravinsky ont bâti des œuvres entières sur la force expressive d’un motif rythmique simple.
Non content d’avoir composé le morceau de piano le plus célèbre du monde (La lettre à Élise), Beethoven, avec l’ouverture de la 5e symphonie, – ta-ta-ta-taaaaaaaaah ! – a également signé le motif rythmique le plus connu. Le tempo Allegro con brio = 96 à 108 à la noire au métronome.
Le rythme est donc le squelette temporel de la musique, la structure sur laquelle la mélodie et l’harmonie viennent se construire. Il fixe le cadre dans lequel le tempo et le métronome prennent tout leur sens.
La mesure, fondement du rythme musical
La mesure est l’un des concepts les plus fondamentaux de la théorie musicale occidentale et l’un des éléments essentiels du rythme. Elle divise le temps musical en unités régulières, permettant d’organiser les durées, de structurer les sons et d’assurer une cohérence dans l’exécution d’un morceau.
Les barres de mesure sur la portée
Sur une partition, une barre de mesure est une ligne verticale tirée à travers toutes les lignes de la portée : elle délimite l’espace des mesures en découpant la musique en segments égaux appelés mesures, marquant la fin d’une unité de temps et le début de la suivante.
Ces barres assurent la clarté visuelle et aident l’interprète à suivre la pulsation et à déterminer où tombent les accents principaux.
Types de Barres
- La barre simple : C’est la ligne verticale standard utilisée pour séparer les mesures.
- La double barre : Utilisée pour marquer la fin d’une section, un changement de chiffrage ou de tonalité.
- La barre finale (ou barre double plus épaisse) : Indique la fin complète du morceau ou d’une œuvre.
- La barre de reprise : Composée d’une double ligne fine et d’une double ligne épaisse avec deux points, elle indique que la section précédente (ou suivante, selon les points) doit être rejouée.
Le très court 7e prélude de Chopin pour piano en La majeur contient 17 mesures et 18 barres de mesure. Notez la barre finale après la dernière mesure, indiquant la fin du morceau.
Les temps dans la mesure
Chaque mesure contient un nombre défini de temps, précisé par le chiffrage en début de morceau (voir plus bas).
Un temps est une unité rythmique de référence sur laquelle reposent toutes les autres valeurs. La mesure n’organise pas seulement les temps, elle leur attribue également des degrés d’importance, ce qui crée une pulsation dynamique.
Temps Forts et Temps Faibles
Dans une mesure, certains temps sont naturellement accentués, créant une structure rythmique perçue.
- Le Temps Fort : Il s’agit du temps sur lequel l’accent principal tombe. C’est presque toujours le premier temps de la mesure. Il procure un point d’appui rythmique.
- Le Temps Faible : Ce sont les temps non accentués.
- Le Temps Moyennement Fort : Dans les mesures à quatre temps (comme 4/4), le troisième temps est souvent considéré comme moyennement fort, portant un accent secondaire par rapport au premier temps.
Exemples d’Accentuation :
- Mesure à 2/4 : Fort – Faible
- Mesure à 3/4 : Fort – Faible – Faible
- Mesure à 4/4 : Fort – Faible – Moyen-Fort – Faible
Remarque : certains métronomes sont capables d’indiquer les temps forts (voir plus bas dans cette page).
Mesure et pulsation
La pulsation correspond au battement régulier que l’on ressent en écoutant ou en jouant la musique. Elle ne dépend pas directement du tempo indiqué par le métronome, mais du découpage interne de la mesure.
Dans la musique occidentale, la pulsation reste généralement constante, ce qui permet aux musiciens de jouer ensemble avec précision. Elle constitue le cadre sur lequel s’appuient les différentes durées de notes.
Le chiffrage des mesures
Le chiffrage de mesure, situé au début de la portée après l’armure de la clé, se compose de deux chiffres superposés
- Le chiffre du haut indique le nombre de temps que contient la mesure. Par exemple, un 3 signifie qu’il y a trois temps dans la mesure.
- Le chiffre du bas indique la valeur de note qui représente un seul temps (l’unité de temps). Ce nombre correspond à la dénomination d’une figure de note :
- 4 = la noire valant 1/4 de ronde
- 2 = la blanche valant 1/2 de ronde
- 8 = la croche valant 1/8 de ronde
- 16 = la double croche valant 1/16 de ronde
Par exemple, le chiffrage 4/4 signifie qu’il y a quatre temps par mesure et que la noire est l’unité de temps.
Mesures simples et mesures composées
Les mesures sont classées en deux grandes catégories selon la manière dont les temps sont subdivisés.
Les mesures simples
Dans une mesure simple, chaque temps est une valeur de note simple – non pointée – et se divise naturellement en deux parties égales.
Les chiffrages les plus courants sont 2/4, 3/4 et 4/4.
- Dans une mesure à 2/4, on compte deux temps de noire, chacun se divisant en deux croches.
- Dans une mesure à 3/4, typique des valses, on compte trois temps de noire, chacun se divisant en deux croches.
- Dans une mesure à 4/4, on compte quatre temps de noire, chacun se divisant en deux croches.
La mesure à 4/4 est souvent représentée par la lettre C majuscule. Elle offre une grande flexibilité rythmique et constitue la base de nombreux styles musicaux, qu’ils soient classiques, populaires ou contemporains.
La première invention pour clavier en Do majeur de J. S. Bach est écrite à 4/4 mais les chiffres ont été remplacées par la lettre C majuscule. La vignette de la vidéo affiche quatre mesures et six barres de mesure.
La mesure à 3/4, quant à elle, est associée aux danses ternaires, notamment la valse, avec un accent fort sur le premier temps et deux temps faibles qui créent un balancement régulier et fluide.
Les mesures composées
Dans une mesure composée, chaque temps est une valeur de note pointée et se divise naturellement en trois parties égales.
Contrairement à ce qui se passe pour une mesure simple, le chiffre du haut n’indique pas le nombre de temps, mais le nombre de subdivisions. Pour trouver le nombre de temps (toujours 2, 3 ou 4), il faut diviser le chiffre du haut par trois.
Les chiffrages les plus fréquents sont 6/8, 9/8 et 12/8. Ces chiffres n’indiquent pas le nombre de temps, mais le nombre total de croches contenues dans la mesure.
- Dans une mesure à 6/8, on compte six croches regroupées en deux temps, chacun équivalant à une noire pointée.
- Dans une mesure à 9/8, on compte neuf croches regroupées en trois temps, chacun équivalant à une noire pointée.
- Dans une mesure à 12/8, on compte douze croches regroupées en quatre temps, chacun équivalant à une noire pointée.
Ce découpage donne un balancement souple et souvent dansant, très présent dans les musiques traditionnelles et dans les mouvements lents du répertoire classique.
La distinction entre mesure simple et mesure composée réside donc dans la manière dont chaque temps se divise. Dans une mesure simple (binaire), le temps se divise en deux parties égales, tandis que dans une mesure composée (ternaire), il se divise en trois.
Ainsi, une mesure à 2/4 et une mesure à 6/8 sont toutes deux des mesures à deux temps, mais produisent une sensation rythmique très différente : dans la première, chaque temps correspond à une valeur simple et se divise par deux (binaire), tandis que dans la seconde, chaque temps correspond à un signe de valeur pointée et se divise par trois (ternaire).
Les mesures irrégulières et asymétriques
Certaines musiques modernes ou traditionnelles emploient des mesures irrégulières, dont la répartition des temps n’est pas uniforme. Des chiffrages tels que 5/8, 7/8 ou 11/8 combinent des groupes de deux et de trois croches, créant des rythmes inhabituels et expressifs. Ces structures confèrent une dynamique particulière et sont fréquentes dans les musiques balkaniques ou contemporaines.
Les chiffres 7/8 au début du 3e mouvement de la 7e sonate pour piano de Prokovief indiquent une mesure à 7 temps avec une croche pour chaque temps
La mesure et l’expression musicale
La mesure ne se limite pas à un cadre technique : elle influence directement la perception du mouvement, du phrasé et du caractère d’un morceau. Une même mélodie jouée en 3/4 ou en 4/4 ne produira pas la même impression. Le choix de la mesure participe donc à l’identité rythmique et expressive de la musique.
Le tempo
Le tempo, ou mouvement, désigne la vitesse d’exécution d’un morceau de musique. Sauf indication de changement de tempo, cette vitesse reste constante et indépendante des figures de note (ronde, blanche, noire…).
Certains musiciens utilisent le terme « pulsation » pour parler du tempo, soulignant l’idée d’un battement régulier qui guide l’exécution musicale.
Savoir « tenir le tempo » est essentiel pour jouer en mesure, que ce soit seul ou avec d’autres musiciens. Cela permet de maintenir la cohésion et l’équilibre d’un ensemble ou d’une formation orchestrale.
Le tempo est donc une dimension essentielle de l’expression musicale : il structure le temps, influence l’énergie et le caractère du morceau, et guide l’interprétation des musiciens.
Remarque : on utilise aussi fréquemment le terme « mouvement ». Il convient de souligner que ce mot peut avoir un autre sens en musique classique : il sert à désigner une partie d’une œuvre musicale qui en comporte plusieurs. Par exemple, les sonates pour piano de Beethoven comportent généralement trois mouvements, mais certaines en comportent quatre et d’autres seulement deux.
Les termes italiens pour indiquer le tempo
Tempo signifie Temps en italien.
Jusqu’à l’invention du métronome au début du XIXe siècle, le tempo était uniquement indiqué de manière peu précise par des termes italiens que les compositeurs utilisaient pour spécifier la vitesse et parfois le caractère souhaités. Ces indications, qui vont du très lent (Grave) au très rapide (Prestissimo), sont aujourd’hui traduites en une mesure concrète et standardisée : les BPM (battements par minute).
Le tableau ci-dessous présente les principales indications de tempo italiennes, leurs équivalents en français, et les fourchettes métronomiques généralement associées à chacune d’elles.
Il est important de noter que si ces valeurs BPM sont des lignes directrices universellement reconnues, leur interprétation peut légèrement varier selon l’œuvre, l’époque et l’intention de l’interprète
| Italien Grave Largo Adagio Andante Moderato Allegro Presto Prestissimo |
Français Très lent Large Tranquille Allant Modéré Vif Rapide Très rapide |
Métronome (BMP) inférieur à 40 40 – 60 66 – 76 76 – 108 108 – 120 120 – 168 168 – 200 200 – 208 |
Ces indications de tempo étant aussi parfois considérés par les compositeurs comme des indications de caractère, cela augmentait encore leur imprécision.

Par exemple, Allegro signifie littéralement « Joyeux ». Pourtant, cela n’empêche pas les compositeurs d’indiquer Allegro au début d’une œuvre sombre ou dramatique !
Tout va changer avec l’invention du métronome au début du XIXe siècle. Il va devenir alors possible au compositeur d’indiquer précisément la vitesse d’exécution de son œuvre.
Le métronome
De Galilée à Winkel
S’inspirant fameusement d’un lustre oscillant régulièrement dans la cathédrale de Pise, Galilée étudie et découvre à la fin du XVIᵉ et au début du XVIIᵉ siècle, les concepts essentiels concernant le pendule.
Inventé au début du XIXesiècle, le métronome permet d’indiquer précisément le tempo.
En 1696, le musicien français Étienne Loulié construit un « chronomètre » basé sur le pendule à secondes de Galilée, constitué d’un poids en plomb suspendu à une ficelle réglable le long d’une règle verticale. Ce dispositif ne comportait pas de mécanisme permettant de le maintenir en mouvement et ne produisait aucun son,
Le premier métronome mécanique à pulsation audible est inventé en 1814 à Amsterdam par le Hollandais Dietrich Nikolaus Winkel : en expérimentant, il découvrit qu’un pendule lesté des deux côtés du pivot pouvait marquer un temps régulier, quelle que soit la vitesse du tempo.
Il offrit le premier modèle de son « chronomètre » musical, daté du 27 novembre 1814, au Hollandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten à Amsterdam.
Malheureusement, il ne protégea pas correctement son idée et, dès 1816, Johann Nepomuk Maelzel (parfois « Mälzel ») ajouta une échelle numérique à l’instrument et le breveta sous le nom de Métronome de Mälzel, qui reste en usage à ce jour.
Ainsi, encore aujourd’hui, Mälzel reçoit souvent à tort le crédit de ce qui était en réalité la création de Winkel.
Vous pouvez voir une photo du métronome original de Winkel sur la page web du Kunstmuseum de La Haye où il est conservé.
Le métronome de Maelzel
Dès 1816, Maelzel commença à fabriquer en série ce dispositif en forme de pyramide sous son propre nom : « Métronome de Maelzel ».
Les chiffres du métronome indiquent le nombre de pulsations par minute. Ainsi, lorsqu’il est réglé sur 60, le métronome bat la mesure 60 fois par minute, soit une fois par seconde.

Beethoven et Maelzel se fréquentaient : l’auteur de La lettre à Élise est l’un des premiers compositeurs à indiquer précisément des valeurs de tempo.
Selon une affirmation controversée d’Anton Felix Schindler, premier biographe de Beethoven, le staccato des vents au début du second mouvement de la 8e symphonie en fa majeur du compositeur allemand parodie le métronome !
Le métronome comme instrument de musique
L’heure espagnole de Maurice Ravel
Créée à l’Opéra-Comique de Paris le 19 mai 1911, l’oeuvre en un acte pour cinq voix solistes se déroule entièrement dans la boutique de l’horloger espagnol Torquemada. L’ouverture est marquée par des métronomes dissimulés dans l’orchestre et réglés à vitesse variable, symbolisant les tics-tacs des horloges :
On entend très distinctement le tic-tad des trois métronomes dans le début de l’ouverture
Selon une fiche technique rédigée par l’opéra de Lyon, il est précisé tout en bas de la page 3, (section orchestre) : 3 métronomes (réglés à la vitesse de 40, 100 et 232 pulsations par minute).
Poème symphonique pour 100 métronomes (Ligeti)
Compositeur majeur de la seconde moitié du XXe siècle, György Ligeti (1923-2006) compose Poème symphonique en 1962, lors de sa brève rencontre avec Fluxus, mouvement artistique qui touche aussi bien la musique que les arts visuels et la littérature.
L’œuvre, qui requiert 100 métronomes, un chef d’orchestre et dix exécutants, est créée en 1963 et fait scandale. Après cette première exécution, elle n’est que très rarement jouée en public.
Version écourtée mais permettant de bien voir le fonctionnement des métronomes
Poème symphonique constitue une expérience à part dans la carrière de Ligeti : le compositeur hongrois qui a écrit plusieurs des œuvres les plus fascinantes de l’histoire de la musique contemporaine a été révélé au grand public grâce au film 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick.
Exemple d’une oeuvre musicale jouée dans des tempi différents
L’ouvre choisie est l’invention à deux voix N° 8 en Fa Majeur de Jean-Sébastien Bach, écrite à 3/4 (chaque mesure contient trois temps ou pulsations et chaque pulsation est égale à une noire).
Cliquez sur les images pour ouvrir la vidéo dans YouTube.
Glen Gould (1:20) – Métronome : environ 103 (Moderato)
Marcelle Meyer (0:43) – Métronome : environ 140 (Allegro)
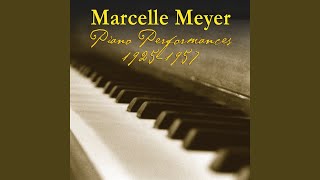
Ordinateur – Métronome : environ 99 (Andante/Moderato)
Foire aux questions
Quelle est la différence la plus importante entre le rythme et le tempo ?
Le rythme concerne l’organisation des durées des notes et des silences (le « pattern » musical), tandis que le tempo définit la vitesse à laquelle ce rythme est joué. Imaginez que le rythme est la chorégraphie d’une danse, et le tempo la musique sur laquelle elle est exécutée.
Comment savoir si un morceau est en mesure simple ou composée ?
Pour faire simple, écoutez la pulsation. Si elle semble se diviser naturellement en deux (vous pourriez taper dans vos mains en comptant « 1-2, 1-2 »), c’est probablement une mesure simple. Si elle se divise en trois (vous compteriez « 1-2-3, 1-2-3 »), c’est une mesure composée. Les mesures composées (comme le 6/8) ont souvent une sensation plus « dansante » ou « balancée ».
En tant que débutant, comment puis-je améliorer mon sens du rythme ?
Entrainez vous à réaliser des rythmes simples avec un métronome.
– Notes blanches : Le métronome bat les noires, vous frappez des blanches (une frappe régulière toutes les 2 pulsations)
– Croches : Le métronome bat les noires, vous frappez des croches (deux frappes de durée égale par pulsation)
– Double croches : Le métronome bat les noires, vous frappez des doubles croches (quatre frappes régulières par pulsation)
– Triolet de croches : Le métronome bat les noires, vous frappez des triolets de croches (trois frappes parfaitement égales par pulsation)
Commencez lentement (60 BPM) et augmentez progressivement la vitesse. L’objectif est de maintenir une régularité parfaite tout en développant votre indépendance rythmique. Pour revoir les valeurs de notes et leur durée, consultez notre page sur les valeurs rythmiques des notes.
Le métronome est-il indispensable pour progresser ?
Bien que l’on puisse progresser sans, le métronome est un outil précieux, surtout pour les débutants. Il agit comme un partenaire de jeu impartial qui vous empêche de ralentir ou d’accélérer inconsciemment. L’utiliser régulièrement dès le début permet de développer une pulsation interne solide, essentielle pour jouer avec d’autres musiciens.
Pour rappel, de nombreuses applications gratuites pour smartphone offrent les mêmes fonctionnalités, souvent avec des options supplémentaires comme des sons différents ou la possibilité d’accentuer les temps forts. Vous pouvez aussi rechercher « métronome en ligne » sur Internet pour en afficher un directement dans votre navigateur.
Comment choisir le bon tempo quand il n’y a pas d’indication (BPM ou terme italien) sur une partition ?
Analysez le caractère de la musique. Une mélodie joyeuse et énergique sera généralement jouée plus vite (Allegro), tandis qu’une mélodie triste ou solennelle sera plus lente (Adagio ou Largo). Écoutez différentes interprétations du même morceau par des musiciens expérimentés pour vous faire une idée du tempo qui semble le plus naturel.
Pourquoi certains morceaux semblent « respirer » et ne sont pas toujours parfaitement en rythme avec le métronome ?
Vous touchez ici à la différence essentielle entre l’exactitude métronomique et l’expression musicale. Le tempo établit une base régulière indispensable, mais certains interprètes utilisent des fluctuations temporelles maîtrisées, notamment le rubato (littéralement « temps volé » en italien).
Il est crucial de comprendre que le rubato n’est pas une licence pour jouer de manière approximative. Cette pratique est historiquement liée à la période romantique, particulièrement à Chopin qui en fit un usage subtil et codifié. En revanche, son application est généralement déconseillée dans la musique baroque et doit être utilisée avec une extrême parcimonie dans le répertoire classique de la première école de Vienne (Haydn, Mozart, Beethoven).
Le véritable rubato n’a rien à voir avec des ralentissements ou accélérations arbitraires. C’est un art qui consiste à « voler » du temps à un moment pour le « rendre » à un autre, en maintenant une pulsation sous-jacente stable. Il s’applique à des endroits spécifiques de la partition pour souligner une tension harmonique, mettre en valeur une note importante, ou accentuer l’expressivité d’une phrase mélodique.
La maîtrise du tempo strict reste donc le prérequis indispensable : c’est seulement après avoir acquis une parfaite régularité rythmique que l’on peut commencer à explorer les nuances du rubato avec goût et discernement.



