Dans la musique occidentale, en solfège, une gamme est une succession de notes conjointes (voisines), ascendantes (du grave vers l’aigu) ou descendantes (de l’aigu vers le grave). Le nom de la première et de la dernière note sont identiques.
Les gammes majeures et mineures, sont composées de huit notes, la gamme chromatique de douze notes.
Une gamme peut être ascendante ou descendante :
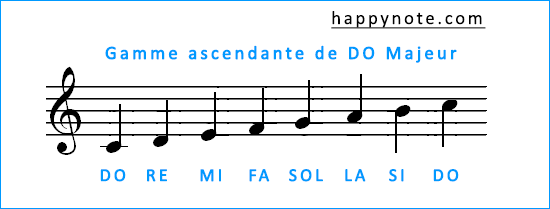
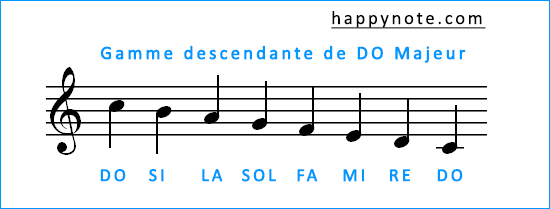
AFFICHER/MASQUER LE SOMMAIRE
Gamme majeure et gamme mineure : la place du demi-ton
En musique, on utilise le ton et le demi-ton pour mesurer l’espace sonore entre deux notes voisines (conjointes).
Selon leur nom, l’intervalle entre deux notes voisines peut être d’un ton – le plus courant – ou d’un demi-ton.
C’est la place qu’occupent les demi-tons dans une gamme qui fixe son mode : majeur ou mineur.

Les huit degrés de la gamme
Les degrés correspondent à la position des notes dans la gamme. Ils s’écrivent en chiffre romain.
Dans une gamme, certains degrés sont plus importants que d’autres et seront plus employés pour écrire les accords servant à harmoniser un morceau.
Les différents degrés de la gamme sont les suivant:
Le degré I : La tonique, qui donne son nom à la gamme.
Le degré II : La sus-tonique.
Le degré III : La médiante (note modale, qui fixe le mode majeur ou mineur de la gamme)
Le degré IV : La sous-dominante.
Le degré V : La dominante.
Le degré VI : La sus-dominante (note modale secondaire)
Le degré VII : La sensible.
Le degré VIII : L’octave (ou tonique)
Débutez ou améliorez votre lecture musicale avec l'aide des notes en couleur !
Les deux degrés les plus importants sont de très loin le Ier degré – tonique – et le Vème degré – dominante.
Les notes modales sont celles qui différencient le mode majeur et le mode mineur d’une gamme. Ainsi, la différence entre la gamme de DO majeur et celle de DO mineur se fait principalement par la note MI se trouvant sur le IIIème degré : MI naturel en DO majeur, MI ♭ en DO mineur.
Notez que l’accord de tonique (DO MI SOL), très important, incorpore cette note modale.
La note modale sur le VIème degré est moins importante : elle n’est incluse ni dans l’accord de tonique, ni dans celui de dominante. De plus, certaines formes de la gamme mineure – gamme mineure ascendante – conservent l’intervalle de 1 ton entre la dominante et la sus-dominante
Les deux modes de la gamme
En musique, il existe deux modes : le mode majeur et le mode mineur.
Comme nous allons le voir, la place des tons et des demi-tons est différente selon le mode, ce qui donne à la musique un caractère différent : plus lumineux pour une oeuvre écrite en majeur, plus sombre pour une oeuvre écrite en mineur.
La gamme majeure
La gamme de DO majeur, représentée par les touches blanches du clavier d’un piano, ne comportant ni dièse ni bémol, est le modèle de toutes les autres gammes majeures.
La gamme de DO majeur est une gamme diatonique, c’est à dire une gamme où toutes les notes ont un nom différent (par opposition à la gamme chromatique de 12 notes où certaines notes ont le même nom).
Le Prélude No 1 du premier livre du Clavier Bien Tempéré de Jean-Sébastien Bach est en Do Majeur
La gamme de DO majeur est construite à l’aide d’une échelle de sept intervalles inégaux. Certaines notes voisines sont séparées par un intervalle d’un ton (distance la plus grande entre deux notes de musique voisines), d’autres par un intervalle d’un demi ton (distance la plus petite entre deux notes de musique voisines).
Les notes de musique conjointes (voisines) – séparées par un ton sont : DO RE -RE MI – FA SOL – SOL LA – LA SI. Celles séparées par un demi ton sont : MI FA – SI DO.
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de touches noires entre MI et FA ni entre SI et DO sur le clavier d’un piano. En effet, les touches noires servent à séparer les tons en deux demi-tons à l’aide des dièse ou des bémols :
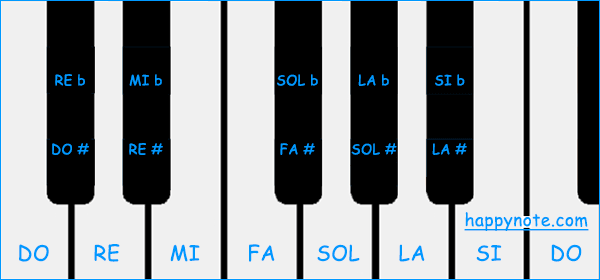
Dans la gamme de DO majeur, les tons et les demi-tons sont placés dans l’ordre suivant : 2 tons, 1/2 ton, 3 tons, 1/2 ton. Cela correspond aux intervalles entre les notes de la gamme de DO (1 ton entre DO et RE + 1 ton entre RE et MI = 2 tons, 1/2 ton entre MI et FA, 1 ton entre FA et SOL + 1 ton entre SOL et LA + 1 ton entre LA et SI = 3 tons, 1/2 ton entre SI et DO.
Toutes les autres gammes majeures, commençant sur une autre note que le DO, doivent elles aussi enchainer les tons et les demi-tons dans le même ordre de 2 tons, 1/2 ton, 3 tons, 1/2 ton. Pour pouvoir y parvenir, elles doivent utiliser des dièses ou des bémols pour hausser ou baisser certaines notes d’un 1/2 ton.
Les 12 gammes majeures
- DO majeur
- SOL majeur (1 dièse : fa)
- RE majeur (2 dièses : fa do)
- LA majeur (3 dièses : fa do sol)
- MI majeur (4 dièses : fa do sol re)
- SI majeur (5 dièses : fa do sol re la)
- FA# majeur (6 dièses : fa do sol re la mi)
- DO# majeur (7 dièses : fa do sol re la mi si)
- FA majeur (1 bémol : si)
- SI♭majeur (2 bémols : si mi)
- MI♭ majeur (3 bémols : si mi la)
- LA♭ majeur (4 bémols : si mi la re)
- REb majeur (5 bémols : si mi la re sol)
- SOL♭ majeur (6 bémols : si mi la re sol do)
- DO ♭ majeur (7 bémols : si mi la re sol do fa)
La gamme mineure
Dans la gamme mineure harmonique (il existe en fait trois gammes mineures différentes), les tons et les demi-tons sont placés dans l’ordre suivant : 1 ton, 1/2 ton, 2 tons, 1/2 ton, 1 ton 1/2, 1/2 ton. Pour pouvoir obtenir les intervalles de tons et de demi-tons dans cet ordre, on utilisera des altérations, c’est à dire, des dièses (#) pour hausser la note ou des bémols (b) pour la baisser. Par exemple, pour DO mineur on utilisera un MI bémol et un LA bémol: DO RE MIb FA SOL LAb SI DO.
La gamme mineure est généralement utilisée pour écrire une musique plus triste, ou plus sombre, ou plus dramatique qu’une musique écrite avec les notes de la gamme majeure.
La célèbre Marche Funèbre de Frédéric Chopin est bien sûr écrite avec les notes d’une gamme mineure (Si bémol mineur)
Les 12 gammes mineures
- LA mineure
- MI mineur (1 dièse : fa)
- SI mineur (2 dièses : fa do)
- FA# mineur (3 dièses : fa do sol)
- DO# mineur (4 dièses : fa do sol re)
- SOL# mineur (5 dièses : fa do sol re la)
- RE# mineur (6 dièses : fa do sol re la mi)
- LA# mineur (7 dièses : fa do sol re la mi si)
- RE mineur (1 bémol : si)
- SOL mineur (2 bémols : si mi)
- DO mineur (3 bémols : si mi la)
- FA mineur (4 bémols : si mi la re)
- SIb mineur (5 bémols : si mi la re sol)
- MI♭ mineur (6 bémols : si mi la re sol do)
- LA ♭ mineur (7 bémols : si mi la re sol do fa)
Les gammes relatives
On appelle gammes relatives des gammes qui ont la même armure de la clef mais dont l’une est majeure et l’autre mineure.
Ainsi, chaque gamme majeure à une gamme mineure relative, et vice versa.
La distance entre une gamme majeure et sa relative mineure est une tierce mineure, intervalle de 3 notes constitué de 1 ton + 1/2 ton diatonique.
Le 1/2 ton diatonique est le 1/2 ton séparant 2 note de nom différent, par exemple SOL et LA♭.
Le 1/2 ton chromatique est le 1/2 ton séparant 2 notes de même nom, par exemple SOL et SOL#.
Ainsi, la gamme mineure relative de DO majeur est LA mineure.
En effet, si l’on compte trois notes en descendant – en allant de l’aigu vers le grave – on obtien DO SI LA. Et si l’on compte 1 ton et 1/2 ton, ou plutôt dans le cas présent, l’inverse, on obtient DO SI = 1/2 ton et SI LA = 1 ton.
Autre éxampe : la relative majeur de SOL mineur est SI ♭ majeur.
Puisque pour trouver la relative mineure d’une gamme majeure il faut utiliser une tierce mineure descendante, pour trouver la relative majeure d’une gamme mineure il faut utiliser une tierce mineure ascendante. Si l’on compte trois notes en allant du grave vers l’aigu, on obtient SOL LA SI. Et si l’on compte 1 ton et 1/2 ton on obtient SOL LA un ton et LA SI♭, 1/2 ton diatonique.
Gamme et armure de la clef
Les dièses et les bémols des gammes ne sont pas placés devant les notes (altérations accidentelles) mais au début de la portée, juste après la clef (altérations constitutives).
Les dièses et les bémols qui constituent l’armure de la clé se succèdent de quinte en quinte (intervalle de cinq notes) et sont toujours placés dans le même ordre.
Ordre des dièses : Fa Do Sol Re La Mi Si
Ordre des bémols : Si Mi La Re Sol Do Fa
Ainsi, l’armure de la clé indique quelle gamme est utilisée pour écrire un morceau.
La gamme chromatique
La gamme chromatique est une échelle de douze intervalles égaux : toutes les notes sont séparées par un demi ton (les tons sont divisés en demi tons à l’aide des dièses et des bémols).

Sur le clavier d’un piano, cela revient à jouer toutes les touches blanches et toutes les touches noires.
Le « Grand Galop Chromatique » de Franz Liszt, est une pièce de virtuosité dont le thème, comme son nom l’indique, utilise largement la gamme chromatique.
Liens de solfège relatifs aux gammes
Les Altérations
Pour modifier la hauteur d’une note on utilise des symboles musicaux appelé altérations : Dièse, Bémol, Bécarre.
Hausser ou baisser une note change sa distance entre elle et les deux notes qui l’entourent, transformant une gamme majeure en gamme mieure et vice versa.